Café rencontre-Psychanalyse
Le 19 décembre 2020 se tenait à Gap dans le cadre des « Café rencontre-Psychanalyse » une conversation entre Guan Jian, auteure de plusieurs livres publiés en Chine et en France et, Jacques Ruff, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP autour des questions ayant trait à l’écriture et la publication.
Cette rencontre avait pour titre : « Plus j’écris français, plus je me sens chinoise »
Vous pouvez lire ci-dessous le préambule de Guan Jian et écouter les échanges entre les participants.
Vous pouvez également commander à partir du site les deux livres dont il est question dans cette conversation « La pluie de l’aube » publié en 2016 et « Si maman était là » publié en 2020.
Lire le préambule Texte Guan Jian pour café rencontre
Ecouter les échanges (en 3 parties, durée totale 1h20)
Partie 01
Partie 02
Partie 03
* * *
Constellation du corbeau de Julie Legrand
* * *
Laurence Marconi « L’ombre de la colline »
Un lecteur, qui préfère rester anonyme, a envoyé cette superbe analyse de ce recueil de nouvelles
Pourquoi ajouter à la Préface stimulante du recueil et aux commentaires qui soulignent les belles qualités des pages de Laurence Marconi ? Simplement pour dire le plaisir ressenti à cette lecture et en remercier l’auteure, en espérant ne rien enlaidir.
Le titre, L’Ombre de la colline, loin de limiter les possibles avec deux noms au singulier déterminés (l’et la), les multiplie. De la colline immobile naît la mouvance de l’ombre qui n’est ni destruction ni mort, mais effacement progressif. Tout le talent se révèle dans les variations pour peindre la surprise de vieillir, cette frontière flottante et mal définie car, pour parodier Ionesco « Tout le monde est le premier à (mourir) vieillir ».
Premier coup de gomme (l’intrus) avec la plaisante tragédie de Claire, prénom prophétique pour affronter l’ombre. L’ennemi est planté dans le décor général, vous ne pourrez plus l’en arracher.
L’ombre gagne un peu plus dans le huis clos de la voiture et les échanges lacunaires de La petite lueur où tout est fait pour retenir le lecteur jusqu’au twist impitoyable. Plus légèrement, dans Sonate d’automne, Henri et Jimmy nous font mesurer que les mots aussi vieillissent mais qu’il y aura toujours une solution pour parler d’amour.
Le lancinant balancement entre l’ombre et la lumière se propage aux autres textes. Café-comptine est une chanson douce : les premiers mots fixent tout à l’insu du lecteur : « trois gouttes de café … comme de son propre sang. » La fin éclaire ce fin mystère de l’incarnation : Milo, Juliette, Gaspar // font, font, font (le nombre 3 du début suggéré ici par la triple répétition de “font”, et on peut ajouter la présentation fractionnée ” Milo et Juliette … et puis Gaspard ” qui est l’écho de “2 + 1 font trois”. En plus du rappel de la comptine célèbre mais sans le négatif… et puis s’en vont … le tourbillon omniprésent se perpétue. Le tourbillon est celui du café (1° §) qui devient par sublimation volutes (2°§) et par intériorisation vertige (3°§), mouvement perpétuel de la vie farandole. Et l’ombre ? Elle ne peut anéantir celle qui se nomme Lucie, la lumineuse, qui comme toutes les lumières attire les papillons : “les enfants papillonnent autour de Lucie”, très belle image fragile, éphémère. Café noir dans la tasse blanche symbolise par les deux “couleurs” l’imbrication de toute vie finissante avec toute vie nouvelle, c’est la même consolation secrète que dans Fragments. Il n’y a pas de retour possible, mais il peut y avoir une forme de recommencement que d’autres vont moduler à leur manière, café … crème, …noir … mais café à jamais ; le verbe “passer” peut s’appliquer à la vie comme au café et la cafetière “murmure” ou “ronronne” car dans cette aventure c’est à elle que revient le dernier mot.
Fragments peint la dispersion de ce qui fit la vie, quasiment une forme de diaspora intime du héros, mais, magnifiquement et conformément à l’étymologie de diaspora il y a l’idée de semer, de germination future : tout objet reprendra vie ailleurs dans sa famille d’adoption, séparation fertile. L’écriture fouille cette métamorphose avec les nombreux verbes au préfixe dé (déposer, déchargé, déballé, débarrasser, démanteler…) marquant le dépouillement, tandis que les gens autour disparaissent dans la foule, s’évanouissent : il y a un nœud secret entre la disparition des objets par cercles de plus en plus étroits autour du héros et la vie qui va se prolonger en cercles de plus en plus larges grâce à ces mêmes objets emportés. Et cela est superbement condensé dans l’alliance du dernier soupir du personnage et du souffle de vie de la brise.
Charmant exercice de style de Remous avec “les îles … flottaient sur la mer” … jeu de cache-cache malicieux avec le lecteur comme avec l’amie d’enfance. Construction en miroir et entrelacement des sens et de la mémoire. Remous ou tourbillon, mot qui revient à plusieurs reprises dans le recueil et qui peut traduire l’intensité des émotions ou la violence qui engloutit tout. Ici tremblement de l’âme, émotion douce et facétieuse du “cyclone” dévastateur …, opposé au Tremblement de chair offrant le cruel « visage ravagé » par la honte vécue. Deux facettes de la vie : le corps complice et gardien des sensations ou le corps déserteur.
Vieillir ! Denise éteint les bougies en les soufflant (un saut dans l’ombre symboliquement), son passé, déroulé chronologiquement, est sans retour possible. Rosa Ortega n’est pas même sûre d’avoir le temps de broder ses 80 bougies. Elle ferme les yeux (c’est la fin ?!) … un instant seulement … car le bric-à-brac qui l’entoure est vivant (on songe à Giuseppe dans Fragments) ; sa mémoire est vivante (p.26).
Tout l’arrière-fond de tissage et de couture de cette histoire est aussi à l’image de l’écriture de Laurence Marconi : la trame solide porteuse de délicats motifs, dans la lignée (étymologique) des rhapsodes.
« Le feu de mon désir » (Remous) « brûlures des doigts » (Tremblement de chair) « « langues de feu » (Vie en noir et blanc), le Stromboli…, tout le recueil dit la flamme à entretenir, dans ce recueil ouvert et clos dans la saison ardente : « C’est l’été » (p.13) et juin … (p.107).
Le lecteur comme les personnages, comme la bouteille lancée au début accomplit le Voyage jusqu’au bout (expression à double entente) et l’ardeur demeure. Le premier texte espère qu’un inconnu pourra le (= le passé) recueillir, le dernier marque cet accomplissement au-delà de la mer, à Ellis Island, un point d’ancrage qui a les caractéristiques de toutes les îles (“à la fois fermes et fragiles, immobiles et tremblantes” = quasiment des adjectifs équivalant aux noms collines et ombre) et de toutes les vies. Les êtres s’éteignent (p. 106 Anna) mais survivent à travers les objets, les autres (« si c’est elle ou, à travers elle, Anna »). Il y a un va-et-vient de la vie à la mort (enflammé le cœur/embrase un ciel d’été//poudre/cendre p.75) et toute mort n’est peut-être qu’une disparition, un effacement momentané (le nom de Mario est gravé à jamais là où il attendait Anna et où il est enterré sans qu’on puisse préciser l’endroit : enfoui et visible) : voilà pourquoi les larmes, le plus souvent, trouvent à s’effacer (p.13/p.107) car il y a toujours quelqu’un pour recueillir (13) /se recueillir (106) et les myosotis/Ne m’oublie pas fleurissent sur la colline (82) puis on les cueille, alternance de la lumière et de l’ombre, comme les carreaux noirs et blancs de la cuisine. Un autre texte reprend ce thème jusque dans son titre (Une vie en noir et blanc) opposant la lumière de l’Italie qui aveugle Louis à l’ombre de son salon (70) et tout le champ lexical du feu (Stromboli oblige !) est réduit au papier … glacé. Le thème de la “disparition” est bien marqué alors par “ne reverra plus jamais Rosine” ce qui n’est pas la mort mais le champ ouvert à la mémoire, forme de résistance au vieillissement. Dans les yeux de Louis il y a une “petite lueur”.
Ajoutons qu’il y a superposition des photos de Louis avec le film de Rossellini, une sorte d’empilement de différents passés, comme si les êtres reprenaient en charge le vieillissement interrompu des autres, pour offrir un prolongement infini. Espérons que les spaghettis de la page 71 ne lui ont pas été servis façon Anna Magnani à Rossellini.
“Aujourd’hui encore, si je ferme les yeux” (expression du rêve … ou de la mort dans Ferry-boat) il y a confusion entre les passagères côtoyées jadis et les mouettes … confusion ou accomplissement poétique de la mémoire car les Sirènes étaient des femmes-oiseaux. Et même si le ferry a fait place à l’Eurostar, les Sirènes font toujours entendre leur chant irrésistible (comme pour Yves le marin du Sablier). Vieillir c’est accepter que la colline offre tour à tour la lumière bleutée des myosotis le jour et étende son ombre à d’autres heures, c’est entrer dans le cycle terrestre de la lumière ou dans celui des vagues qui « viennent de l’Est invisible, une à une patiemment, repartent vers l’Ouest inconnu”, comme l’écrivait Camus. Vieillir est à l’image de cet inlassable brassage.
Au total ce recueil tout en équilibre et finesse, au maillage serré mais discret, offre un monde quasiment inépuisable : les effets d’échos, les miroitements d’une page à l’autre nous guident dans un univers sans nostalgie car sans retour possible et nous font connaître “les vents et les courants” pour échapper aux tourbillons et posséder ainsi comme maison (vie) “la dernière à être avalée par l’ombre de la colline”.
***
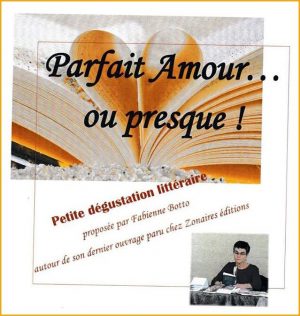 À écouter : extraits du recueil de nouvelles “Parfait amour” lus par l’auteure Fabienne Rivayran.
À écouter : extraits du recueil de nouvelles “Parfait amour” lus par l’auteure Fabienne Rivayran.
***
Les Ravissants de Julie Legrand, recueil chroniqué par Zerbinette dans la revue Azenda (La Réunion).
 * * *
* * *
La passerelle du hasard de Désirée Boillot, recueil chroniqué par Viviane Campomar dans l’émission littéraire de J.C. Caillette “Le lire et le dire” sur Fréquence Paris Plurielle
* * *
La passerelle du hasard de Désirée Boillot, recueil commenté par Martine Galati
Il est toujours un peu difficile de présenter un recueil de nouvelles, et encore plus quand il nous a particulièrement plu. Par quelle nouvelle commencer ? Faut-il parler de toutes ? Et si non, sur quels critères baser sa sélection ?
Je vais donc tout d’abord vous dire que ce recueil “La passerelle du hasard” est né sous la plume aguerrie de Désirée Boillot, qu’il vient de paraître chez Zonaires Editions et que l’auteur nous y offre dix nouvelles d’une très grande qualité littéraire, sensibles, troublantes, dont l’humour est loin d’être absent, et qui, chacune dans son style, chacune dans son sujet, y révèle des situations d’aujourd’hui, des drames de la solitude, mais aussi des petites espiègleries, des petites mesquineries, qui soulagent ou, pour le moins, permettent de s’accorder avec la vie ou l’humeur du jour.
Prenez par exemple ma préférée (parce que, oui, j’ai une préférée !) “A l’autre bout du banc”. Cette femme, qu’on devine d’un certain âge, qui aime l’automne, va-t-elle finalement accepter de partager son banc, celui sur lequel elle aimerait tant apposer son nom pour qu’il soit sien et qu’elle n’ait pas à le partager justement ? Difficile quand on a pris certaines habitudes, érigées par une solitude que la vie nous a imposée. Difficile en effet d’accepter que d’autres, un autre, se trouve dans une solitude similaire et ait choisi ce même banc, peut-être pour des raisons identiques… ou pas.
Difficile, ça l’est tout autant et sûrement davantage, quand il s’agit de faire son deuil d’une mère qui a tout donné pour sa carrière, sa célébrité, une mère absente forcément. Comment parvenir à pardonner tous ces manquements qui ont fait qu’on s’est construit toute seule ? Comment accepter qu’on ne puisse plus revenir en arrière, que ce qui est passé s’est passé, qu’il n’y aura pas de deuxième chance ? Peut-être, tout simplement, en parlant, en disant, en évoquant quand même ce lien, cette parenté, ces racines qui sont ce qu’elles sont mais qui sont les nôtres et en les transmettant à notre tour, du mieux qu’on peut, comme une passerelle. Du hasard ?… (nouvelle éponyme)
Et puis, sourire de cet homme qui se pare d’une moustache éloquente, l’entretient avec le plus grand soin, l’adapte à toutes les situations. Sourire de ce “pacte” passé avec Céline, le jour de leur mariage : jamais elle ne lui demandera de la couper, sa moustache. Mais un pacte n’est-il pas fait pour être rompu ? Avec toutes les conséquences que cela peut entraîner bien sûr. Et ne plus sourire… (Porte-bonheur)
Sourire encore de cet homme (encore un !) qui fait le rêve prémonitoire de gagner au loto, qui mémorise tous les numéros gagnants, les joue et attend le résultat avec une impatience difficilement contrôlable, commençant à douter, notamment du dernier numéro. Quelle revanche ce serait en effet que de pouvoir partir loin de sa famille, de son fils qui n’a plus aucun respect pour lui, malgré cette maladie qui le condamne à court terme. Quel beau cadeau, il offrira ainsi à sa maîtresse, Martine. Mais pourquoi donc n’arrive-t-il plus à se souvenir de ce dernier numéro ?!! (Absence)
Sourire cette fois avec Oriane qui, non seulement doit subir les commentaires et réflexions désobligeantes d’une belle-mère toute imprégnée de sa pseudo autorité, mais également ceux sarcastiques et de plus en plus méchants, de son mari Jérémie, pour qui elle est très loin d’arriver ne serait-ce qu’à la cheville de sa mère. Rien n’est trop beau, trop parfait pour Madame sa mère. Mais la patience et la docilité ont des limites que Jérémie ferait bien de ne pas franchir… (Saturday Night Fever)
Voilà. Je n’en dirai pas plus sur cet excellent recueil. Je ne vous dirai rien sur “Et peut-être rêver”, “Le lustre”, “Le roi du macadam”, “Accident de parcours” et “Regard volé”. Non pas parce que ces nouvelles ne le méritent pas, bien au contraire ! Mais parce que je préfère que vous les lisiez vous aussi, que vous vous en appréciiez chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque contenu, que vous partagiez également toutes ces émotions, qui vont du sourire aux larmes, et que Désirée Boillot sait si bien valoriser. L’écriture de ces nouvelles révèlent une maîtrise parfaite de ce genre littéraire. Tout a l’air de couler de source et c’est bien là qu’on en ressent toute la qualité. Car nous savons bien justement, vous et moi, que rien ne va jamais de soi et qu’il faut un sacré talent pour nous laisser penser que c’est possible, que tout peut arriver. Dans un sens, comme dans l’autre.
* * *

Ma vie n’a pas plus de rides que la surface de cette tasse de thé bon marché…
Guan Jian, La pluie de l’aube, Zonaires éditions, 2016, 125 p. 13,50 €.
Une bibliothèque diocésaine a pour mission principale de mettre à disposition de ses publics des ouvrages de théologie et d’histoire de l’Église. Elle s’inscrit forcément dans un territoire et, donc, est parmi les acteurs du livre de celui-ci. Mettre en valeur la littérature locale est l’un des rôles de ces bibliothèques. En effet, depuis deux millénaires, l’Église a participé à l’histoire de la littérature.
Guan Jian, dont la biographie se trouve sans difficulté sur internet, vit en France depuis 1990. Si elle réside à Lyon aujourd’hui, elle est aussi Gapençaise. Elle répond, par les actes, à la question posée page 10 : « tu te sens facilement chez toi partout. Comment fais-tu ? »
Lors de la publication de La pluie de l’aube, Guan Jian a été interrogée par Héléna Patras, pour RCF Alpes-Provence. L’interview est disponible sur le site de l’éditeur Zonaires. L’auteur avait également donné à la parution de La clé de mes songes, une interview pour l’émission commune à RCF Alpes-Provence et Fréquence Mistral, Marque Page.
N’oubliez pas les saveurs de notre pays
La Pluie de l’aube est un recueil de nouvelles. Chacun des textes peut se lire indépendamment même si l’ouvrage a une cohérence d’ensemble. Le style poétique, empreint de nostalgie, donne tout son cachet à l’ouvrage, comme le souligne Françoise Guérin, elle-même nouvelliste lyonnaise, dans la préface.
Si ce recueil est évidemment œuvre d’imagination, il nous dit beaucoup de la vie de l’écrivain et de ses pays. Elle-même écrit (p 119) « J’ai le sentiment de marcher dans ses pas [ceux de Yan Shan Shan, l’héroïne]. Elle vit en moi. C’est comme si j’avais avec moi l’âme de cette femme que je n’ai jamais connue ».
Luc-André Biarnais archiviste du diocèse de Gap et d’Embrun
* * *
Frédéric Gaillard – Jeux de dopes
cyclisme-dopage.com – Stéphane Huby
Frédéric Gaillard s’empare de la légalisation du dopage, vieux serpent de mer de quelques-uns, et pousse la logique jusqu’au bout dans une nouvelle loufoque et, qui sait, visionnaire. Il a bien compris que légaliser le dopage revient à le rendre obligatoire puisque tout espoir de réussite serait vain pour qui voudrait pratiquer son sport sainement. Une fois ces rares mais nocifs sportifs à l’eau clair ayant été chassés, tels Christophe Bassons chassé par Lance Armstrong, le Tour de France de la dope peut s’élancer sous les vivats de la foule en délire, au premier rang desquels figurent sans doute les anciens fans de Richard Virenque ou de Laurent Jalabert. Avouons-le, le Tour que nous décrit Frédéric Gaillard est infiniment moins ennuyant que celui que nous propose chaque été France Télévision à l’heure de la sieste. Il fait franchement envie et on rigole (jaune, bien entendu).
Que les partisans de la lutte antidopage qui se font un max de fric grâce à elle (comme nous) se rassurent. L’auteur a aussi prévu le maintien des contrôles, cette fois pour détecter et sanctionner sévèrement les sportifs non dopés. Qu’il en soit ici remercié. Si sa prédiction prend forme, nous pourrons lancer un www.cyclisme-eauclaire.com et continuer à vivre grassement au soleil de Tahiti. Quant à vous, nous vous conseillons la lecture de Jeux de dopes, une lecture parfaite pour vous changer les idées entre Rolland Garros, Euro de foot, Tour de France et Jeux Olympiques.
* * *
Ma lecture du nouveau et beau recueil de nouvelles de Thierry Radière “Quand les femmes parlent après l’amour” paru chez Zonaires éditions
Écoute et amour
Au moment où la parole se libère, des femmes se racontent. Dans ce qu’elles ont de plus personnel, que leur propos soit grave ou plus futile. Elles se racontent au passé (« C’est important les souvenirs », dit une d’elles), au présent (sur ce qu’elles viennent de vivre) mais aussi au futur de leurs attentes. Il n’est plus ici, vu les circonstances, question d’un parler séducteur, érotisé visant à un coït.
Quand nous faisons l’amour, peut-on entendre dans la bouche d’une autre, c’est comme si tu rechargeais les batteries de mon âme.
La femme qui parle est sécurisée affectivement, elle se confie sans contrainte d’aucune sorte. Elle veut aussi marquer l’amant de sa parole.
“Je veux que tu te souviennes de moi, de mon histoire »
« La mémoire, c’est plus intime que le sexe », lit-on dans les propos d’une autre femme. Et une autre encore trouve que se raconter est plus impudique « à la limite » que la vie sexuelle.
Elles sont vingt-neuf. Il y a l’amoureuse des Belges qui guette chez son amant des signes de belgitude. Celle qui fait l’amour dans le noir ; celle au sexe naturellement parfumé à la fleur ; celle qui ne vit que pour écrire; l’étudiante tombée amoureuse de son prof ; celle qui entend des bêtes au plafond ; celle dont la passion est de cultiver un jardin ; celle qui admire l’œuvre de Basquiat, l’Ile de Ré ou Fanny Ardant, physiquement et intellectuellement ; celle qui parle d’un livre qu’elle a aimé ; celle qui déteste les hommes mous en tout, ce qui qui nous vaut une des plus belle pages sur ce thème.
Ce sont surtout des femmes heureuses qui s’expriment, font entendre leur voix. Aucune panne, nul fiasco de l’homme à déplorer qui justifierait d’une rupture du dialogue, d’une clôture du langage.
Toutes créent un lien entre sexe et mémoire. Toutes sont en attente d’une écoute, de quelqu’un qui retiendra leur parole.
Les prises de parole sont rendues sur deux ou trois pages maximum. On pourrait croire, à quelques détails près, que c’est la même femme, jamais prénommée, qui parle, à divers moments de son existence. Le titre de chaque intervention est fait de la coordination de deux substantifs, de deux propositions comme Cadeau et quotidien, Promesses et obscurité, Je sais et je vis…
En fait, Thierry Radière rend hommage à toutes les femmes. On peut aussi penser qu’il parle (même si l’homme de chaque nouvelle demeure muet), se dit à travers elles. Il ne faudrait surtout pas réduire le propos littéraire de l’ouvrage à un aspect prosaïque, assimiler le recueil à un reportage, une enquête, voire un témoignage de l’auteur puisé à diverses sources alors qu’il s’agit de pures fictions, cela dit, tout à fait vraisemblables.
À la fin, on se dit que l’entente, au sens propre, est un acte d’amour au même titre que le contact physique et, quand elle le prolonge et que le partenaire est à l’écoute, la relation est parfaite. La liaison amenée à se prolonger… D’ailleurs, lire, n’est-ce pas aussi écouter l’autre de l’auteur ? Un acte d’amour qui, s’il est partagé, après l’écriture, fonde une union réciproque propice à des échanges futurs entre lecteur et écrivain autour d’un livre, d’une parole commune ?
Éric Allard du site Les Belles Phrases
* * *
Toi, ma p’tite folie, Danielle Akakpo, collection Lapidaires
N’ayez pas peur, je ne vais pas vous fredonner cette chanson de Line Renaud quoique cela pourrait contribuer à faire tomber la pluie qui nous manque en ce moment. Non. Je vais me contenter de vous glisser quelques mots à propos du dernier recueil de nouvelles de Danielle Akakpo paru dans la collection Lapidaires chez Zonaires éditions.
Lapidaires, les sept nouvelles de ce recueil le sont assurément. Et une “p’tite folie”, tous les personnages principaux de ces nouvelles en possèdent une belle !
Que ce soit la transformation radicale liée au mariage de Madame (Feuilles mortes et pétales de roses), celle qui rêve de son amant jeune et musclé le jour de son anniversaire de mariage (Mon moine rondouillard), celle qui fête la “Saint-Valentin” en compagnie de son amant “rien qu’à elle”, celui qui profite de la fête nationale pour s’offrir une nuit de folie (Vous parlez d’un quatorze juillet), celle qui assouvit sa vengeance familiale incognito (L’amour n’était pas dans la grange), l’écrivain en panne d’écriture qui espère retrouver l’inspiration dans un coin paumé à la campagne (La porte bleue) ou encore celui, jeune bachelier, fuyant le destin tracé pour lui par son père et cherchant sa voie artistique (D’une folie à l’autre), toutes et tous ont en eux ce petit quelque chose, ce petit grain qui va les faire passer de l’autre côté du miroir ou les obliger à seulement s’y contempler encore longtemps.
Tout ce qu’on peut dire de ce recueil optimiste et hors normes, c’est que sa lecture nous fait un bien fou. Danielle Akakpo y écrit avec une légèreté bienvenue et nous réjouit quel que soit le sort final qu’elle réserve à ses protagonistes. Quel qu’en soit l’intensité dramatique, ‘humour est omniprésent. La joie, la sincérité et la dérision s’en mêlent et côtoient allégrement tout un panel d’émotions qu’on ne peut que partager.
Les textes sont courts, ardents et nous retournent comme une crêpe en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire et même pour l’écrire.
Ce recueil se lit à toute vitesse, vitesse grand V même et on ne s’en rend compte que lorsqu’on atteint la dernière page. Danielle Akakpo nous a pris, nous a émus, nous a retenus, presque emprisonnés, et on ne lui en veut surtout pas. Car elle nous a surtout fait rire en relevant comme personne la dérision de toutes les situations évoquées. Elle nous a entraînés dans son p’tit grain de folie créatrice. Et pour tout cela, on la remercie !
Martine Galati
* * *
« Est-ce que les enfants jouent pendant les guerres ? » recueil de nouvellesde Jacqueline Dewerdt-Ogil
Donner son avis sur un recueil de nouvelles est une gageure. Composer un recueil de nouvelles en est une bien plus audacieuse.
Écrire une nouvelle c’est enfourcher un cheval bonasse, le mettre au trot puis au galop en lui murmurant à l’oreille : tout beau mon vieux, on tient la piste, mais on ne s’emballe pas. La fin viendra sans mort d’auteur ni de canasson.
Certes il y aura des obstacles, des trépignements, des retours juste pour apprécier le chemin parcouru. Si l’auteure connaît l’itinéraire, elle feint d’ignorer l’issue du voyage… pour se faire une surprise. C’est sa récompense.
Un cadeau qu’elle nous fait, en toute complicité…
Chouette alors ! Où allons-nous aboutir après 3, 4, 5 pages ?
Une molle étendue de sable, un abîme, un mouroir et pire ?
Les nouvelles de Jacqueline Dewerdt-Ogil nous dispensent des ficelles et autres manigances qui incitent à refermer un bouquin à la deuxième page.
Ses textes sont polis aux deux sens du terme. Habile magicienne un peu clown, l’auteure nous entraîne de rêveries en surprises. Ses histoires m’ébouriffent l’imaginaire, titillent mes grammaires. Jacqueline me bluffe à en demeurer stupide, interloquée. Ah ! Cet art de la phrase tranquille que viole de suite le coup de bélier. Et toc ! Jacqueline ne fait ni tapisserie ni tricot. Son écriture est virile au sens de vigoureuse. Sensibilité pas de sensiblerie. Pas de psychologie à deux balles.
Mme Dewerdt-Ogil est une auteure contemporaine. Ses textes sont des « installations » réjouissantes. La langue s’y débrouille, pulsée, rythmée sans jamais s’alourdir ou s’embrouiller. Elle élague, jette les inutilités, trouve la beauté qui est simple, évidente.
Les thèmes sont souvent des histoires de familles, solitudes, deuils impossibles, vies en jachère, inabouties, cruautés ordinaires au point qu’on ne les perçoit plus. Cette vie grinçante et folle que Jacqueline Dewerdt-Ogil repère sans grands tralalas. Au lecteur les frais de l’intelligence.
Oui, la vie est chienne (Vita Brevis), oui les êtres sont insondables (Alice sous l’averse). Mais il y a aussi des mystères (Le Miracle).
L’art de la nouvelle, selon moi, c’est écrire peu pour dire tout. C’est l’art poétique. Jacqueline D-O. y excelle.
À lire à petits pas, à savourer sans modération. Revenir, repartir, s’étonner d’un mot, d’une rupture. Enfin prendre plaisir.
Recommandez ce livre à vos amis gourmets de beaux textes. Noël est proche.
Marité Jacquet, auteure
* * *
Est-ce que les enfants jouent pendant les guerres ? recueil de nouvelles de Jacqueline Dewerdt-Ogil
Encore un coup de cœur, allez-vous me dire? Eh bien, oui, j’avoue et je l’assume complètement. Ce recueil de vingt nouvelles que Jacqueline Dewerdt-Ogil vient de publier chez Zonaires Editions est une petite merveille du genre.
Le style est fluide, net, sans fioritures, percutant et va droit au but. Et cela, dès la première nouvelle, celle qui donne son titre au recueil et qui, elle-même, est tout cela à la fois et bien davantage.
Dans l’interview qu’elle a eu la gentillesse de m’accorder, Jacqueline Dewerdt-Ogil parle de ses nouvelles comme autant “de personnes qui partent tout en conservant un regard tourné vers le passé, dans un sens allant donc du présent vers le passé”. Certes il est question de ce regard porté sur avant dans plusieurs de ces nouvelles. Mais pas dans toutes et je ne peux donc être totalement d’accord avec l’auteur.
Si cette affirmation se révèle vraie dans la nouvelle éponyme qui nous parle d’un retour au pays après la guerre et de recherches d’identité, de racines permettant de se construire, elle l’est beaucoup moins dans “Vita brevis” où le passé par la simple évocation d’une mère disparue mais encore omniprésente occupe toute la place et n’en laisse aucune au présent.
Même ressenti pour “Virtuelle randonnée” qui retrace une rencontre éphémère, aboutissement logique d’une longue correspondance virtuelle, bien ancrée dans notre aujourd’hui et “Brève rencontre” où le hasard d’une discussion inattendue permet de prendre conscience de la place accordée à une situation d’autrefois qui n’a plus lieu d’être à présent.
Là où je suis d’accord avec l’auteur, c’est quand elle nous dit que ces nouvelles relatent des situations inabouties ou mal digérées ou niées. C’est effectivement le cas à de nombreuses occasions et c’est peut-être ce qui m’a le plus émue dans ces textes aussi divers que variés. Des personnes de tous horizons sociaux, culturels, professionnels ressentent les mêmes émotions, connaissent les mêmes sentiments remettant ainsi, d’un coup, chaque chose à sa place. Le bien, le mal, le blanc, le noir, le gris de la vie frappent à égale distance, que l’on soit riche ou pauvre, bien dans sa peau ou hésitant. Toutes ces émotions, tous ces sentiments, chacun est à même un jour ou l’autre de les ressentir, de les exprimer. Et c’est ce qui fait la force de ce recueil, ce côté équilibré, d’égalité qu’on a un peu (beaucoup?) tendance à oublier lorsque l’on est confronté à une certaine “injustice” et qui se dit ici librement et fort justement.
Une belle écriture qui claque, concise, directe et franche. Voilà ce que nous offre Jacqueline Dewerdt-Ogil. Voilà ce que j’ai apprécié dans ce beau recueil et qui me fait porter cette lecture au rang de “coup de cœur”!
La palme revenant très certainement à la nouvelle “Le vase bleu” bref échange de lettres entre un frère et sa sœur qui, comme qui dirait, sent vraiment le vécu!
De la belle ouvrage, oui!
Martine Galati, journaliste
* * *
Généalogie de l’exode d’Emmanuelle Cart-Tanneur
Exode, exil, migrations, déplacements, fuites et déroutes… Toutou-risme peinard.
J’aime les histoires, les contes, les récits et surtout de voyages.
Je ne crache pas sur ce qui a été une des grandes joies de ma vie : treks, virées diverses à Pied, à vélo, en bus, en bateau, à chameau ; bof ! Je suis un Homo Sapiens après tout !
La nouvelle d’Emmanuelle Cart-Tanneur nous trompe joliment par son titre savant. On s’attendrait à un essai sur les migrations, un truc ennuyeux qui ne nous apprendrait rien. Son conte enseigne mieux que des statistiques. Un conte c’est de la chair humaine, bien à cœur, bien palpitante : chacun y puise ses sujets de réflexion en toute liberté.
J’aime les contes fantastiques sur fond de poésie botanique. Ce Pablo je le vois en beau brun « patalant » sur des sentiers scabreux. Mais ce n’est pas le sol qui s’effondre sous ses pas, c’est le réel ! Alors chapeau à l’auteure. Délicieuse chute. Embarquement immédiat : le passé n’est jamais bien loin. Déjà il s’annonçait par la musique magique du « Silbo » !
J’aime qu’instruits de nos voyages nous en nourrissions nos écrits, qu’avec délicatesse nous retournions la peau du monde jusqu’à en dévoiler la sanglante obscénité.
J’aime cette nouvelle moebienne bien dans l’esprit de Cortazar. J’aime les éternels retours. Les êtres humains qui marchent, qui s’en vont, qui prennent tous les risques parce que peut-être ce sera mieux là-bas quitte à trouver pire. L’esclavage, la noyade, la solitude assurés. Mais Sapiens est un lutteur, un éternel survivant.
Sapiens depuis son départ de la grande faille s’est battu pour copuler, il s’est battu pour dominer et éliminer. « T’es pas un ange mon pote ! » Aujourd’hui, il est nombreux partout : c’est vous c’est moi, c’est Pablo, c’est la file interminable des demandeurs d’asile, c’est notre auteure vadrouilleuse.
Les poètes font de la poésie comme ils respirent. Allez donc les en empêcher ! J’aime leur exode joyeux sur les chemins qu’ils inventent. Merci Emmanuelle d’être de cette plume-là.
Marie-Thérèse Jacquet, auteure
***
Double issue de Désirée Boillot
L’amère tension du manque
Le mythe de Cendrillon réactivé ? C’est bien le moins pour une telle figure, en attente éternelle de la reconnaissance d’un regard… Double issue, c’est le récit d’une jeune déshéritée, une « Desdichada » que tout prédestinait au bonheur : son intelligence, sa curiosité des choses de la vie, son goût pour la rêverie et son amour immense des livres. De la déshéritée elle a toutes les qualités : du regret de l’enfance perdue à la douceur nostalgique d’un amour pour le père défunt, de la tendresse déchirante pour une mère obligée de se mettre en quatre pour l’éduquer à l’admiration sans faille pour l’amie au nom de fleur et de ville italienne : « Florence »…
Son prénom à elle, c’est « Arielle ». Un prénom aux consonances aériennes, légères, à la fois comme l’ « air » et comme « elle ». Ce qui fait : «elle air»… « elle erre » ? C’est bien vers la Méditerranée heureuse que ses errances imaginaires entraînent par exemple les rêves de notre « Desdichada ». En l’occurrence vers Palerme, patrie lointaine du clan maternel que la mère devra rejoindre au cours du récit à la faveur d’un coup fâcheux du hasard. Laissant à Paris sa petite Arielle aux prises avec le monstre – la « tante Thérèse » -, la mère bien aimée abandonne sa fille aux serres d’une véritable harpie, acariâtre, jalouse et avare, qui réactualise la figure de la marâtre des contes. Entretemps d’autres prises – de bec, de risques, mais surtout de mesures radicales, définitives et sans appel – auront été assumées par cette Cendrillon d’un nouveau genre qui, décidément, n’a pas froid aux yeux.
Ce qui est beau ici, c’est le miroitement des figures féminines dont le récit est le prisme. Sommes-nous bien dans une nouvelle version de Cendrillon ? Ou bien dans un « Pays des Merveilles » qui serait comme le retournement maudit d’une réalité perdue dont le chemin passe par l’exploration d’une cave habitée par les rats ? Car il y a aussi, chez l’Arielle de Double issue, de Désirée Boillot, un peu d’Alice, qui va de découverte en épouvante mais sait si bien, finalement, se rire des monstres… Et il y a, enfin, une « fille du feu », qui regarde vers le volcan au loin, attendant l’éruption, mais qui se montrera capable de la provoquer. Double de l’« Octavie » nervalienne qui ne peut, en guise d’amour, que s’attacher à la figure tyrannique d’un vieillard malade et impotent qui requiert sans cesse ses soins vigilants, « Arielle » est surtout en effet un prénom auquel il manque, durant tout le récit, un nom : le nom du père, évanoui dans les limbes profonds de la mort et de l’oubli, mais pourtant si présent dans l’amère tension du manque qu’il suscite, et dont le récit se nourrit jusqu’à la déflagration réparatrice.
Eliane Thépot
* * *
Double issue de Désirée Boillot
Je viens de lire le beau commentaire de Sylvie Dubin à propos du roman de Désirée Boillot, « Double issue ». Livre dense que j’ai dévoré puis grignoté. Au pays des rats il serait imprudent de ne pas se faire rongeur. Puis songeur. Bonjour tristesse.
Sourire, cependant n’est pas inutile quand on pénètre au pays des êtres absurdes.
Il faut bien se protéger de ses propres démons quand on les rencontre au tournant d’une page. Peut-être que la littérature nous tend des miroirs où se reflètent nos tentations de folie ?
Je pense bien évidemment à tous les obsessionnels de notre littérature, les marionnettes de Molière, de La Bruyère (ah ! la belle époque !). Monstres certes mais tellement pitoyables qu’on aurait envie de les consoler d’être aussi bêtes. Le sexe ! Le sexe ! Pas les tocs !
Ce Tonton aurait excellé dans l’art de composer des tableaux faits de matériaux de récupération. Mais chez lui aucune sublimation, pas plus que chez sa femelle. Leur amour de la merde (car vouloir être trop propre, chercher la saleté pour la soumettre n’est-ce pas une manière d’érotisme de bas étage ?) se transmute en sadisme minable à l’encontre de leurs parentes. Genêt et ses « Bonnes » ne sont pas loin…
La nièce. Oh la jolie petite humaine disposée à la torture ! Une Arielle, une abeille dans cette ruche folle. C’est elle qui va recevoir le trop plein de rage de ses oncles et tante.
Son amour pour sa mère, femme sans défense, prisonnière d’une intégrité qui la livre à divers martyrs, cet amour de l’adolescente pour sa mère fait d’Arielle une protectrice engagée jusqu’à l’ultime. Mais elle n’en sortira pas indemne cette enfant courageuse et inventive.
J’aime l’écriture de Désirée Boillot. Au plus près de son sujet. Je l’imagine se régalant à construire ces caricatures humaines. Par sa plume, nous sommes dans la sensibilité d’une ado des années 1960.
Nous voyageons dans son monde intime sans psychologisme. Seuls comptent les actes qui en disent long sur les âmes et leurs intentions.
Un beau roman mené tambour battant dans un monde désolé. Une métaphore de notre monde où s’accumulent les gains des marchés tandis que d’innombrables humains en sont réduits à fuir l’esclavage, pour tomber sous le joug d’autres Entreprises. Frères humains exposés à la mort ou à une vie « underground ». Les dératisations ne sont pas réservées aux rongeurs.
Marie-Thérèse Jacquet, auteure
* * *
Double issue de Désirée Boillot
« Et puis l’oncle était radin » : tel est l’incipit de ce roman, et son insolite argument. Car c’est bien la pingrerie de l’oncle Marcel et de la tante Thérèse qui est au cœur de l’intrigue. La jeune Arielle, contrainte de s’installer chez eux avec sa mère, se voit privée de tout : de confort matériel, de nourriture, d’intimité, de liberté, et surtout, surtout, de tendresse. La mère, assurément aimante, est une victime trop consentante pour être d’un quelconque soutien. N’était la présence de la blonde Florence, l’amie patiente et attentive, et les rêveries dans la cave où elle trouve refuge, Arielle serait dans le plus profond désespoir. Double issue, donc, que cette amitié et ce havre souterrain, double lieu d’où combattre le risque de dépouillement et la sécheresse du cœur.
Un lecteur pressé pourrait s’arrêter là, à l’histoire vivement contée d’une sorte de Cosette moderne. On rit plus qu’on ne pleure à l’évocation de certaines scènes : l’oncle « partant à la pêche aux fruits talés, aux légumes très murs, à la viande bien avancée » abandonnés sur le marché, ou attrapant avec un aimant les pièces jetées par les touristes dans la Fontaine Médicis ; la tante inventant un système de minuterie pour rationner l’eau de la salle de bain ou « s’enfermant à double tour pour compter son flouze ». Oui, on rit, jusqu’à ce qu’on se trouve nez-à-nez avec les rats.
Et des rats, il y en a de vrais et de figurés dans ce roman faussement lisse. À commencer, bien sûr, par l’oncle et la tante qui, nous dit la narratrice dès la page 12, « vivaient comme des rats ». La mention du rat, précoce dans le texte, n’est pas innocente. L’animal renvoie bien, dans l’imaginaire occidental en tout cas, à l’avarice, mais aussi à une certaine intelligence dévoyée, cruelle. Arielle rencontre ce rat dans la cave, installé à sa place dans le canapé : il est énorme et « les billes rouges de ses yeux [la] fixaient avec insistance ». Cette rencontre est capitale. Elle va faire basculer l’histoire de la petite fille innocente, fragile, persécutée, vers quelque chose de beaucoup plus trouble. Comme si Arielle la brune avait reconnu dans le regard du rat sa part sombre. Comme si elle y avait vu son double…
Le compte rendu de lecture doit s’arrêter là, sous peine de dévoiler l’issue de l’intrigue. Qu’on se dise seulement que cette issue n’est pas si simple qu’on pourrait le croire : le roman de Désirée Boillot porte décidément très bien son titre !
Sylvie Dubin, auteure
***
Le radeau de Victoire de Marie-Thérèse Jacquet
Le radeau de Victoire est un roman dont la construction en triptyque s’organise autour de la figure de la mère, La résistante, qui en est le volet central. Le premier volet, c’est le père, un boulanger de métier qui n’est pas avare en compromis et que l’on surnomme « Le Boche », parce qu’il est alsacien et qu’il parle parfaitement la langue de l’occupant ; Victoire, leur fille, constitue le dernier volet.
Victoire a bien du mérite. Sa mère est intransigeante et suspicieuse, et même si par certains côtés elle est admirable de force dans un monde où tout est précaire, son caractère de cochon pousse sa fille à développer des stratégies pour préserver son équilibre. Equilibre que Madame Pérignon lui procure à travers l’amour qu’elle lui porte.
Ce roman d’une rare authenticité et d’une force d’écriture étonnante, offre une galerie de portraits où les femmes sont à l’honneur. Celui de Madame Pérignon en constitue sans doute le plus touchant. Le roman s’ouvre sur une scène de complicité d’une très grande poésie entre la fillette et elle; à chaque fois que ces deux-là se trouvent en présence, le monde s’efface, quelque chose se remet à battre.
Tout au long de ma lecture j’ai été frappée par l’authenticité qui se dégage de la petite enfance de Victoire ; il y a là une vérité qui passe par le regard de la fillette. L’auteur manifeste une immense tendresse pour ses personnages, en particulier pour cette mère forte en gueule qui se bat de bout en bout du roman. Certaines scènes m’ont émue, d’autres m’ont fait rire aux larmes, aucune ne m’a laissée indifférente ; c’est sans doute à cela qu’on reconnaît les vrais écrivains.
Désirée Boillot, auteure
• • •
Le radeau de Victoire de Marie-Thérèse Jacquet
J’ai commencé à lire « Le rat d’eau de Victoire ». C’est l’histoire sans date d’une gamine sans nom, sans âge.
On devine qu’elle est très jeune, car ses phrases ne comportent qu’un mot ou deux. Elle est dans la période où l’on passe du « pot » aux WC des grandes personnes. Elle se penche
au-dessus du trou…. C’était plus que ne pouvait supporter. Je suis allé dans mon jardin, j’ai creusé mon trou, et j’ai enterré le livre.
Le soir venu, tarabusté par le devenir de la gamine, j’ai couru dans le jardin déterrer le livre et je me suis replongé avidement dans sa lecture. Que l’on se rassure : la gosse n’avait pas disparu dans les égouts. J’ai fini par comprendre que l’histoire se passait pendant la Seconde Guerre mondiale et
qu’elle était racontée à travers la perception de l’enfant, cette perception qui s’aiguise au cours du temps et qui fait que le tableau, partant d’une esquisse, prend corps peu à peu sous les touches du pinceau.
Bref, elle est fille de boulangers, part en exode avec sa mère et son petit frère dans la voiture familiale, en laissant le papa à la maison (il est Alsacien, il pourra se débrouiller avec les boches). Quand la famille revient, elle constate que le papa en a profité pour s’acoquiner avec une jeunette… Bref, j’arrive à la page 73 pour constater avec bonheur que mon intuition était bonne. La gamine est née en 1937, elle a donc un peu plus de deux ans au début du livre. Il faudra attendre encore un peu
pour savoir qu’elle s’appelle Victoire, car tout le monde ne l’appelle que Poupette.
Cette façon d’écrire et de décrire est finalement très poétique et dans la lignée du célèbre poème de Verlaine « L’art poétique » dans lequel il est écrit qu’en poésie, il faut que l’indécis au précis se joigne.
Il y a beaucoup de coqs à l’âne dans lesquels l’auteure retombe toujours merveilleusement sur ses pieds. C’est vraiment « voluptueux ». Certains mots « savants », inconnus de la gamine sont déformés de manière croustillante comme « les bassines de coq » et autre « loulou de pomme
et radis ». Ce qui me permet de retomber moi-z-aussi sur mes pieds en rappelant le titre, « Le radeau de Victoire ».
J’avoue être jaloux de ce livre et que j’hésite à aller l’enterrer une seconde fois, car étant né en 1940, c’est un peu mon histoire que l’auteure à raconté (ou plutôt celle du petit frère de Victoire, qu’elle appelle le collabo !). Elle me coupe l’herbe sous le pied. Je suis aussi parti en exode en voiture,
mais la différence est qu’elle était poussée par ma mère. Rouen-Alençon à pied, ça fait une trotte, et le mois de juin 40 était caniculaire !
Merci donc, Marie-Thé, pour ces belles pages dont la lecture a fait ressurgir beaucoup de mes souvenirs.
Jean Calbrix, auteur
* * *
Le radeau de Victoire de Marie-Thérèse Jacquet
A peine ai-je embarqué sur « Le radeau de Victoire » que je file à la rencontre de mondes multiples:s’entrecroisent, voire s’entrechoquent les gens d’un quartier populaire d’une ville du Nord,les membres variables d’une famille de boulangers, les occupants, des prostituées, des bêtes aussi, tous jetés dans les rapides de la guerre et les affres de l’Occupation.Ce cadre âpre,aux moeurs brutales et menacé de dislocation constitue le milieu éducatif de cette fillette: Victoire,la bien nommée. « Le radeau de Victoire »,aussi instructif qu’il puisse être sous l’angle de la connaissance pour un anthropologue,un sociologue des moeurs ou un psychologue,répond cependant à une autre intention,me semble-t-il. C’est le récit des souvenirs gardés de son enfance que l’auteur nous livre certes, mais c’est surtout l’expérience très personnelle des sensations,émotions,affects et mouvements d’âme qui traversent le corps et la psyché de l’enfant. Nous sommes invités à partager l’expérience de cette fillette grandissant dans une liberté faite de contraintes et de déréliction. »Le radeau… » va moins vers le temps retrouvé qu ‘il ne s’approche de la sensibilité de Victoire,restituée parce qu’étonnemment conservée dans une mémoire corporelle constituée alors et aujourd’hui traduite dans la langue par le texte. Au temps du monde, celui de l’époque, vécu par la fille du boulanger, errant dans la guerre comme Fabrice sur le champ de bataille de Waterloo, se substitue un temps intime, scandé par l’éclosion de la sensibilité et les progrès de la conscience. Cette mémoire sensorielle, mêlant impressions, images,affects et mots d’alors,l’auteur semble l’avoir cultivée depuis toujours pour enfin la reconfigurer ici dans un texte qui donne la parole à l’enfant qu’elle gardait secrètement en elle. L’étonnant n’est donc pas tant la précision et la justesse des évocations que le point de vue original adopté sur ce qu’est éprouver et comprendre,lorsqu’on est un enfant. Rentrer dans le monde de Victoire,c’est goûter au plaisir de voir renaître, avec sa vérité et sa fraîcheur,le monde de l’enfance, à hauteur d’enfant, par la magie d’un style dépouillé d’interprétations, sans surplomb ni fausse naïveté,au ras de la vie. Confrontée rudement aux autres, ballottée, Victoire se bat pour survivre et trouver son chemin dans un certain chaos. Mise en mots, représentable,l’expérience devenue dicible est maîtrisée et partageable, enfin. Peut-on y voir un témoignage d’un style spécifique en littérature qui exorcise l’angoisse, apprivoise l’émotion, les dépasse dans une trace poétique, une oeuvre.Cette langue qui peint et qui guérit en même temps crée les conditions de ce style singulier : le style résilient, mais joyeux!
Marc Hominal, professeur de philosophie
* * *
Un automne en août de Jean Calbrix
En passant par la Picardie j’ai trouvé le roman de Jean Calbrix dans une librairie locale.
Comme la photo de couverture me rappelait un paysage de chez moi, j’ai acheté le volume et suis allée m’installer à l’ombre d’une meule de foin. Bouteille d’eau et couvre-chef antisolaire.
J’aime la vie aux champs. Pas la grande surface à marchandises.
IL faisait chaud, je me suis assoupie ; réveillée en sursaut de temps à autre par le vacarme d’un tracteur conduit par un mec pas mal qui m’a lancé (il avait du coffre) alors vous aimez la lecture ?
J’ai relevé ma capeline et ce chaud lapin de Robert (j’ai fini par apprendre son nom au bistrot du village) n’a pas demandé son reste. Il craint les grands-mères ce délicat ! Quant aux autres femelles …
Enfin le Robert m’a réveillée à nouveau un peu plus tard. IL conduisait une vieille dodoche. IL m’a lancé : « alors la mémé, il est pas encore fini ce livre ! » Je lui ai fait un doigt.
A la campagne on lit lentement avec ces mouches, ces brins de paille qui taquinent et vous font perdre le fil. Je suis allée me désaltérer au village. Le Robert y était avec sa copine, une brune pulpeuse et son copain Gaston (bougre !) lui aussi appareillé d’une beauté rustique. J’ai commandé un lait fraise et me suis assise à l’ombre d’un vieux chêne. Oh il y avait du monde ! Les anciens tapaient du carton ou méditaient en fumant leur pipe. Des jeunes plutôt remuants, travailleurs agricoles pour la plupart. C’était calme. Je me suis endormie devant mon lait fraise et puis coup de tonnerre ; la baston qui s’était déclarée entre les villageois et une bande de blousons noirs venus à moto. Robert et ses potes ont gagné mais y avait du sang.
De toute façon le gros souci de la population c’était ce météorite qui avait envoyé des radiations toxiques. Les céréales allaient mal. J’ai jeté mon sandwich au jambon. Immangeable.
Apparemment personne ne savait qu’il y avait une guerre coloniale de l’autre côté de la Méditerranée. Le Robert pérorait, la sagesse en personne et à l’imparfait du subjonctif plus quelques calembours. Il est allé aux écoles ce travailleur agricole, mécano de surcroît ! Je suis certaine qu’il a côtoyé Calbrix sur les bancs du lycée.
Calbrix nous peint un monde rural qu’il construit longuement, qu’il édifie comme on monte des œufs en neige, comme on monte des bottes de paille les unes sur les autres. Et puis badaboum ! Avec une rage jubilatoire, il déconstruit. Les premiers « légos » subtilisés ne mettent pas trop en danger l’édifice. Il retire les cartes du château une à une avec une joie perverse. Enfin lisez le livre pour en découvrir la fin !
Si vous êtes sensible vous allez souffrir. Si vous êtes un brin iconoclaste alors vous allez vous amuser jusqu’à l’écrabouillement final ! Calbrix ce n’est pas Giono ce serait plutôt Hara qui rit.
Quant à moi je me suis retrouvée assise parmi des pissenlits à raconter des histoires si tordues que mes enfants m’ont embarquée pour l’asile.
Marité Jacquet, auteure
Les cent derniers jours (collectif d’auteurs)
Outre le fait de constituer la toute première publication de la toute nouvelle maison d’édition Zonaires, ce recueil de nouvelles Les cent derniers jours a aussi le mérite de révéler à la face du monde la vision et la perception de quelques trente auteurs nouvellistes sur ce qu’ont représenté, pour eux, ces « cent derniers jours » avant notre dernière élection présidentielle.
La campagne électorale battait déjà son plein lorsque Patrick L’Écolier, « barman » actif et plein de ressources, maître d’œuvre du Café Littéraire Philosophique et Sociologique Calipso, a eu cette véritable idée de génie. Les auteurs habitués du lieu ont tous été conviés à relever ce défi littéraire d’un genre nouveau, n’hésitant pas à mettre la barre de la qualité de plus en plus haut pour le seul et unique plaisir des lecteurs.
Ça, c’est pour la petite histoire ! Car ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas tant de savoir qui en était (quoi que…), ni qui a écrit quoi (quoi que… bis), mais bien de découvrir comment ce collectif d’auteurs a envisagé cet évènement de dimension nationale dont les retombées n’en finissent toujours pas de nous étonner.
Alors il y a « Les 100 choses à faire ou à défaire pendant une campagne électorale » de Franck Garot, qui constituent le fil rouge du recueil et nous font presque regretter de n’y avoir pas pensé nous-mêmes.
Il y a aussi le fameux « Bleu Mogador » de Patrick Denys, qui nous révèle l’univers tragique des « sans-papiers » à travers la vision optimiste qu’un pays « accueillant » s’acharne à maintenir vivace. Bouleversant et tragiquement vrai.
La loufoque « Histoire d’amour » de Danielle Akakpo côtoie allègrement la fable d’Yvonne Oter « Les deux coqs et la poule » ou la raison du plus fort n’est pas toujours celle qui en a l’air… Avec sérieux ou déraison, avec dérision ou solennité, avec prudence ou inconscience, chacun, chacune s’est exprimé avec sa force et son talent d’écriture. L’émotion est bien présente également, qui n’oublie pas la nécessaire touche d’humour pour nous rappeler que tout ceci reste bon enfant, au pire ces histoires paraissent comme des bonnes blagues, des connivences échangées sur le zinc d’un café. Sauf que…
Sauf que ces récits nous interpellent plus que ce que l’on voudrait bien laisser croire finalement. Si quelques uns nous font sourire, voire carrément rire, la réalité d’autres ouvre la porte à bien des réflexions. Est-ce ainsi que nous voulons la France ? Cette élection présidentielle a eu lieu avec le résultat que l’on sait. Attendu ? Espéré ? Regretté ? Refusé ? Nous nous garderons bien d’en juger. Sauf que, encore une fois, nous serions bien au fait de faire nôtres les dernières intentions de Franck Garot « 94. Rappeler à toutes fins utiles que les mots « candidat » et « candide » n’ont pas la même étymologie », « 96. Se dire que dans certains pays on se bat pour avoir la possibilité de voter », « 97. Prier pour que la prochaine on aille voter pour le meilleur et pas pour le moins pire » et surtout « 99. Aller voter » en prenant garde cependant à la centième !
Martine Galati, journaliste


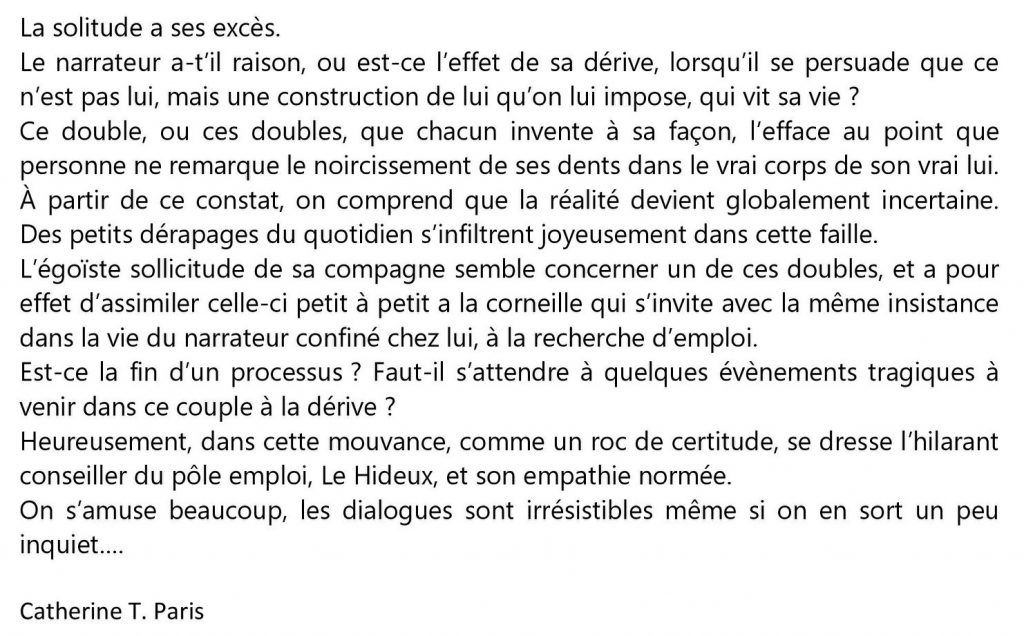
oui ce n’est pas toujours évident de se rappeler qu’on a été un enfant.Cela peut être une difficulté quand j’essaie de restituer au début du roman les émotions visions et sensations d’un bébé d’à peine trois ans et d’accompagner ce regard ces sensations au fur et à mesure qu’ils se complexifient. L’égocentrisme du petit se gomme peu à peu car le monde se révèle en visions brutes qui ne peuvent être intellectualisées. C’est cela qui m’intéresse cette perception du monde au ras des pâquerettes sans faire du “littéraire” qui serait une tricherie en ce qui concerne l’écriture de ce roman d’enfance.Le regard d’un enfant est poésie. J’espère l’avoir montré dans ce livre.
Je viens de finir Est-ce que les enfants jouent pendant les guerres ?, un recueil de 20 nouvelles qui confirme le talent de Jacqueline Dewerdt-Ogil : cette façon de poser le décor à petites touches discrètes, de croquer les personnages avec une tendresse parfois un peu moqueuse, de les conduire à ce point de déséquilibre où ils sont obligés de se révéler. Et puis, Jacqueline est aussi une vraie raconteuse d’histoires, beaucoup avec une chute comme dans la nouvelle qui ferme le recueil, d’autres au contraire comme suspendues, dans une fin ouverte ou énigmatique. Ma préférée ? Sans conteste “Des mains de pianiste”, d’ailleurs très représentative de l’univers de l’auteure : Pas tout facile la vie ! Mais il y a des livres qui “empêche[nt] [le] ciboulot de tourner fou comme le pédalier quand la chaîne du vélo est tombée”.
Sois tranquille, Jacqueline, je sais maintenant que “la flotte ça ruine les bouquins” ; alors le tien, de bouquin, je le garde précieusement à l’abri. Pour le jour où.
Sylvie
Est-ce que les enfants jouent pendant les guerres ? de Jacqueline Dewert-Ogil
Jacqueline Dewert décrit avec autant de finesse que de profondeur des mondes parallèles, comme dans l’Invasion, des êtres qui se ratent comme dans Keske tu fé ? ou n’osent révéler leur penchant comme dans Les mots pour le dire, des jeunes qui tentent de survivre, comme dans Huit lettres, des expériences retrouvées, comme dans Le miracle, un numéro d’acrobates avec une surprise à la toute fin, comme dans Jeux de piste. Mondes qui se croisent le temps d’une brève rencontre et s’ouvrent sur une prise de conscience, une nécessité, une phrase qui en dit long… Tous ces moments de vie composent un puzzle où l’être se cherche comme dans le récit de ce professeur d’histoire qui n’en finit pas de porter son deuil et s’interroge sur le sens de sa vie : Vita Brevis reste pour moi la nouvelle la plus forte et la plus touchante de ce recueil inspiré où l’écriture aborde des sujets graves et toujours traités avec beaucoup de finesse et de sensibilité.